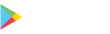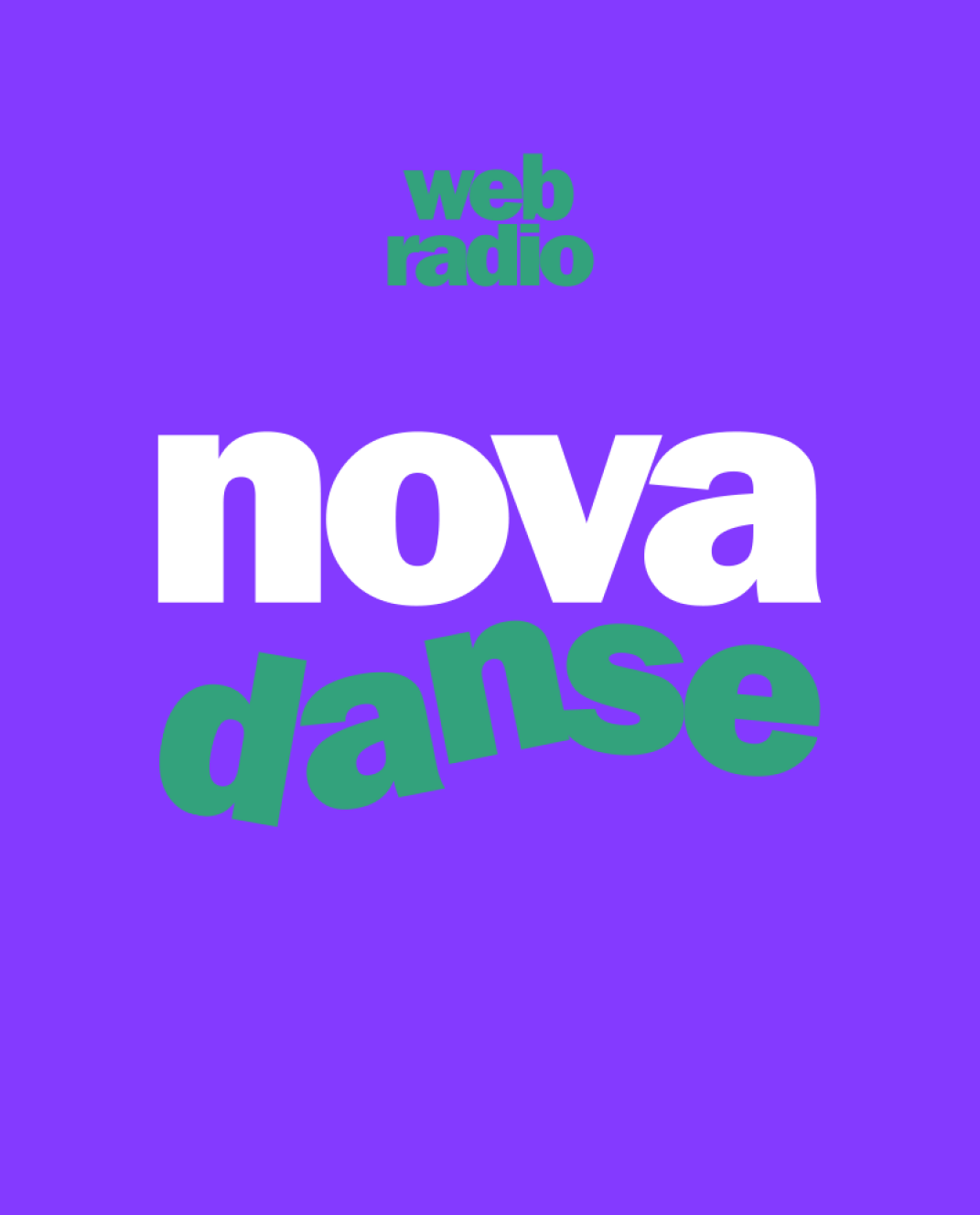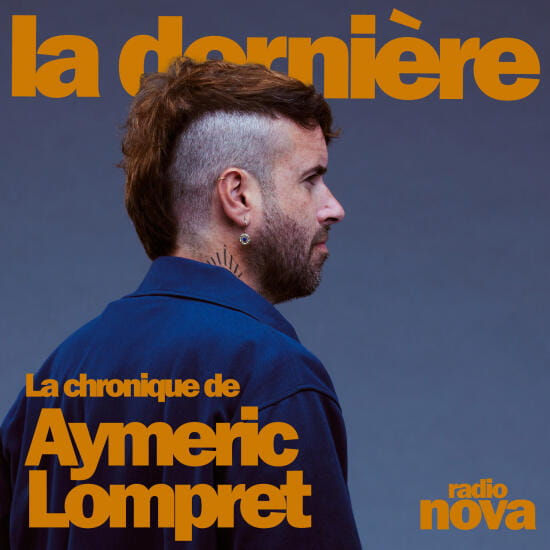Au musée de l’Homme et de l’Immigration, on suit les banlieues au fil des siècles : le champêtre du XIXe, les zonards boueux aux portes de Paris du XXe siècle, en passant par la colonisation des banlieues par l’architecte Haussmann.
L’exposition nous propose un bond dans le temps, pour nous présenter l’histoire des banlieues. Saut au 19e siècle, lorsque les banlieues étaient synonymes de campagne un peu champêtre, où l’on croisait des maraîchers, des canotiers, des bourgeois en promenade dominicale… On y voit aussi les peintres de l’époque, s’installant aux guinguettes pour profiter de ces espaces naturels, loin du tumulte de la vie citadine. Joli cadre, idyllique même, mais qui n’a pas survécu au XXᵉ siècle.
Les zonards du périph’
D’abord, il y a eu la “Zone”, qualifiée par l’écrivain Émile Zola de “sinistre et boueuse”. C’était une sorte de bande de terre aux portes de Paris, ville qui à l’époque était entourée de grands murs. La Zone était ainsi une sorte de no man’s land, utilisée historiquement par les militaires puis abandonnée. C’est ici que depuis, les paysans trouvaient refuge, victimes de l’exode rural. C’était en parallèle le refuge des citadins, eux-mêmes victimes des hausses de loyers à Paris. À cette époque, ces réfugié·es étaient appelé·es des zoniers et de façon péjorative, des zonards (et c’est de là qu’est née l’expression !).
Il y a tout de même eu des tentatives pour rendre cette zone plus agréable à vivre, plus verte, mais les deux guerres mondiales du XXe siècle ont eu raison des jolis projets. Ainsi est né le périphérique de Paris !
La banlieue, poubelle du Paris Haussmannien
Dans le même temps, le préfet napoléonien Haussmann détruit Paris pour moderniser la ville. Le projet urbain inclut de “coloniser” la banlieue (mot employé par les journaux à la fin du XIXe siècle). L’objectif est simple : y mettre tout ce dont la ville ne veut pas. Les usines, les prisons, les hôpitaux, les entrepôts, mais aussi les logements sociaux… En bref, les pauvres, sont virés de la ville. On connaît par la suite l’histoire des Trente Glorieuses, qui font pousser un tas de grandes tours, souvent un peu trop rapidement pour qu’elles perdurent dans le temps.
Voilà comment se sont retrouvés en banlieue le prolétariat urbain et rural, puis les différentes immigrations. La suite, c’est maintenant à nous de l’écrire…
Puisque c’est toujours mieux de construire le futur en connaissant le passé, nos Banlieues Chéries, multiples et diverses sont à redécouvrir au Palais de la Porte Dorée à Paris, jusqu’au 17 août.